Nicolas Mathieu: 'Leurs enfants après eux'
Die beiden Studierenden Anna Seibert und Nils Altmann haben den Roman 'Leurs enfants après eux' von Nicolas Mathieu jeweils ausgehend von ihren Leseerfahrungen kommentiert. Wir freuen uns, dass wir ihre Texte hier mit Ihnen teilen dürfen!


Moritz Heß

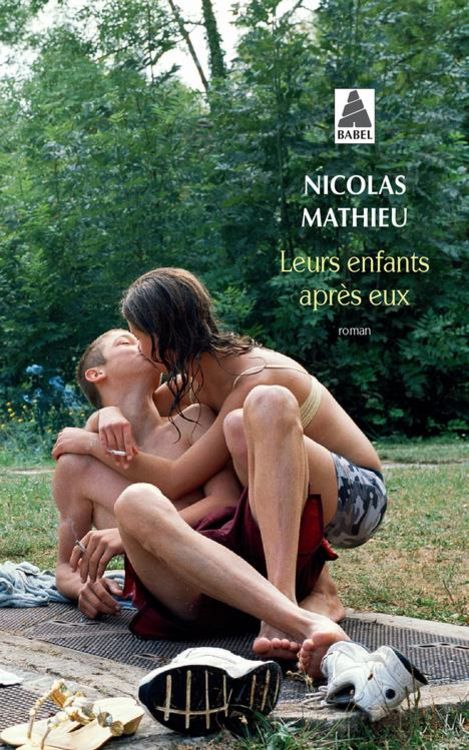
Here we are now, entertain us – en quoi la chanson Smells Like Teen Spirit de Nirvana offre-t-elle un potentiel d’identification aux jeunes du roman Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu ?
Anna Seibert
Comment réussir si le monde autour de nous semble nous mettre des bâtons dans les roues ?
De nombreux·ses adolescent·e·s ont dû se poser cette question pendant les années 90 en France. Depuis les années 70, la France faisait l’objet d’un ralentissement économique qui influençait fortement les opportunités des jeunes, qui étaient pourtant censé·e·s rentrer dans le marché d’emploi. La croissance économique des Trente Glorieuses, de laquelle profitaient ceux et celles né·e·s avant 1955, avait perdu son essor et par conséquent, les générations suivantes devaient faire face au chômage et à une stagnation salariale.[1] Ce nouveau manque de perspectives a suscité une jalousie entre les groupes d’âge, à tel point que la génération précédente a été dénoncée comme voleurs de futur.[6] De plus, ces défis économiques n’étaient pas temporaires, mais ont causé des désavantages permanents – si les jeunes ne pouvaient pas être soutenu·e·s financièrement de leurs familles, iels se sont retrouvé·e·s rapidement semé·e·s.
Les adolescent·e·s du roman Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu, publié en 2018, sont exposé·e·s à des circonstances pareilles. Mathieu raconte l’histoire d’un groupe d’ami·e·s – Anthony, Steph, Hacine et Clem – qui viennent d’Heillange, une petite ville française près de la frontière luxembourgeoise. Face aux défis de la jeunesse, qui apporte entre autres les premières expériences amoureuses, la pression de groupe et la recherche d’identité qu’il faut essayer de naviguer, chacun·e bat ses propres combats, que ce soient les problèmes familiaux d’Anthony, les difficultés scolaires de Steph ou les soucis financiers de Hacine.[5]
Dès leur plus jeune âge, les adolescent·e·s ont des aspirations et ambitions qui sont mentionnées à plusieurs reprises. Steph en particulier exprime le rêve de devenir parisienne (cf. p. 138) et ensemble avec Clem, « les filles se sent[ent] libres et compt[ent] en silence les promesses que leur [doit] la vie » (p. 123). Cette personnification de la vie implique les attentes de chacun·e envers
elle : de pouvoir s’épanouir et d’avoir une certaine liberté de choix. C’est seulement après quelque temps que Steph comprend que ses attentes sont basées sur une image idéalisée de la vie et que dans le monde réel, tout le monde n’a pas les mêmes opportunités (cf. p. 244). Bien que les jeunes commencent lentement à comprendre la vraie étendue de leur statut social au cours du roman, dès le début iels ressentent une aversion contre leur ville de naissance, ce qui peut être interprété comme prémonition. Cette aversion est exprimée de nombreuses fois, surtout par Steph et Clem, qui sont les seules à réussir à vraiment quitter Heillange.
De plus, la ville semble mener une vie à elle-même, qui est exprimée à l’aide de phénomènes naturels et ses descriptions, notamment à travers les motifs de la chaleur, du temps, et du silence. La chaleur est souvent employée pour décrire la paresse et l’ennui des jeunes (cf. p. 14, 60), elle fonctionne donc comme miroir d’émotions qu’iels expriment rarement à voix haute. Cette internalisation et suppression des émotions sont représentées par le silence, qui est dans la majorité des cas mentionné en même temps que la chaleur. Le temps est décrit comme « une pâte, grasse, étirable à l’infini. Chaque jour, c’était pareil. Dans le creux de l’aprèm, un engourdissement diffus s’emparait de la cité » (p. 61). Cette lenteur est soulignée par la métaphore de la « prison des jours » (p. 131), qui prête aux personnages une passivité forcée et implique que c’est le milieu qui ordonne le rythme des vies. C’est l’entourage qui supprime la liberté de choix. La nature fonctionne donc également comme métaphore de la défavorisation sociale des habitant·e·s de la ville. Son image trompeuse idyllique n’est pas dévoilée des touristes, puisqu’iels voient de la paix et du calme (cf. p. 348), alors que les habitant·e·s vivent les dysfonctionnements sociaux cachés et sachent que le paradis se trouve ailleurs. Pour eux et elles, la ville émet « une tristesse mercantile » (p. 148) en toujours restant identique et résistant à tout développement (cf. p. 218). C’est à cause de cette inertie que les adolescent·e·s ne savent pas quoi faire d’eux et elles, qu’iels se posent « la question rituelle, la même dix fois par jour » (p. 68) : qu’est-ce qu’on fait ? Cet état les fait ressentir de la « déprime » (p. 68) et de la « misère » (p. 324). La vie à Heillange est parfaitement résumée par la description suivante :
« Tous partageaient le même genre de loisirs, un même niveau de salaire, une incertitude identique quant à leur avenir et cette pudeur surtout, qui leur interdisait d’évoquer les vrais problèmes, cette vie qui se tricotait presque malgré eux, jour après jour, dans ce trou perdu qu’ils avaient tous voulu quitter, une existence semblable à celle de leurs pères, une malédiction lente. Il ne pouvait admettre cette maladie congénitale du quotidien répliqué. Cet avenu aurait ajouté de la honte à leur soumission. » (p. 389). En conséquence, de toutes ces émotions négatives internalisées – l’angoisse, la honte, la pudeur, la frustration face à la perte de liberté de choix – est né le besoin d’un exutoire, qui est dans le roman la musique. Elle a pour objet exactement les problématiques refoulées des jeunes et peut ainsi leur aider à gérer leurs propres émotions. Elle peut même être considérée comme « outlet of aggression », « a cathartic purging of emotion in a healthy way ».[3] De plus, pendant une période de vie comme la jeunesse, qui est marquée d’incertitude, il peut être rassurant de pouvoir s’identifier à quelque chose et de profiter d’une sorte de communauté qui est créée par la musique. La musique fonctionne donc comme mécanisme compensatoire pendant une rébellion silencieuse contre la société et ses normes.
En utilisant le titre « Smells Like Teen Spirit » pour la première partie du roman, Mathieu lie son histoire fictive à une musique et un genre fortement critique de la société. Le grunge est considéré comme un mélange de punk et de heavy metal. À l’aide de ses paroles, la musique donne une introspective aux émotions d’apathie, d’angst et d’aliénation. Elles expriment également le désir d’être libéré des normes sociétales.[4] Le genre se tourne contre le mainstream et souligne l’importance d’authenticité, même si avec Nirvana, le grunge est devenu exactement ce qu’il luttait contre. À l’époque, la chanson rencontrait un succès fou, qui est décrit dans le roman : « Et cette chanson [Smells Like Teen Spirit], comme un virus, se répandait partout où il existait des fils de prolo mal fichus, des ados véreux, des rebuts de la crise […]. À Berlin, un mur était tombé et la paix, déjà, s’annonçait comme un épouvantable rouleau compresseur. Dans chaque ville que portait ce monde désindustrialisé et univoque, […] des mômes sans rêve écoutaient maintenant ce groupe de Seattle qui s’appelait Nirvana » (p. 51 sq.). En se penchant sur les paroles de la chanson[2], il devient évident pourquoi les jeunes s’identifient autant avec elle. L’angst, une angoisse existentielle, est thématisée dans le pré-refrain, qui consiste en une question rhétorique « Hello, hello, hello, how low? ». Elle crée un sentiment de solitude – on essaie de se faire entendre, mais personne ne répond. La phrase « how low » renvoie au statut bas sociétal des adolescent·e·s. La répétition de ce verset souligne la gravité de cette réalité et renvoie à la perte continuelle de leurs rêves au cours du roman. Suivi du verset « With the lights out, it’s less dangerous », Cobain évoque l’ignorance qui, souvent, aide à faciliter la manière dont nous gérons des problèmes. Cependant, même si l’ignorance est tentante, elle ne peut être maintenue que temporairement et les sujets refoulés finissent toujours par nous rattraper.
« Here we are now, entertain us » fait référence à la vie quotidienne des jeunes et leur « question rituelle » (p. 60) de quoi faire. La monotonie écrasante produite par la ville se transmet sur eux et elles et leur vole toutes nouvelles idées et motivations. Cela évoque le désir de se divertir pour être distrait·e. Cette existence cause les sentiments de stupidité et d’être contagieux·se et conduit à une perte de confiance en soi, soulignée par le verset « I’m worse at what I do best”. L’incertitude et les insécurités caractéristiques pour la jeunesse sont aggravées par la situation sociale. Le manque de perspectives crée le sentiment d’aliénation, de perte de contrôle de sa liberté et des décisions concernant sa propre vie. On retrouve dans la chanson des références à un groupe d’ami·e·s similaire à celui du roman, notamment dans les versets « Load up on guns, bring your friends » et « our little group has always been ». Même si quelques jeunes d’Heillange arrivent à quitter la ville, iels y retournent assez régulièrement, ce qui évoque les mêmes émotions qu’à l’époque. C’est comme si on était remonté dans le temps et c’est pour cela que le groupe „always will [be] until the end“. Ce verset montre aussi la difficulté de s’adapter à une autre couche sociale comme l’expérimente Steph à l’université (cf. p. 328). Même si elle a été élevée dans une situation plus favorisée que les garçons, elle doit faire un effort pour apprendre les normes et règles de ce nouveau monde qu’elle entre à Paris.
Quand on n’arrive pas à échapper à son statut social – comme Anthony et Hacine – il ne reste que la résignation. Mathieu la décrit en parlant de la réception de la chanson : « Ils […] tâchaient de transformer leur vague à l’âme en colère, leur déprime en décibels. Le paradis était perdu pour de bon, la révolution n’aurait pas lieu ; il ne restait qu’à faire du bruit » (p. 51 sq.). Le bruit évoqué ici forme l’antithèse au motif du silence, mais il semble ne pas être assez pour provoquer des changements. Il représente plutôt une plainte de quelqu’un coincé·e sans issu. Le dernier verset de la troisième strophe “Oh well, whatever, nevermind » démontre cette apathie, le début d’un état d’indifférence, en liant la chanson au titre de l’album Nevermind. On pourrait donc supposer que ce ton de résignation pose la thématique-clé présente sur tout l’album. La répétition de la phrase « A denial », qui conclut la chanson, souligne encore une fois qu’il est plus facile de rester dans le déni et reflète ainsi le destin de quelques jeunes du roman. Leur statut social les prédétermine à mener une vie qui ressemble à celle de leurs parents, sans pouvoir s’épanouir ou réaliser des objectifs, ce qui forme le lien au titre du roman.
Pour conclure, on peut constater que la critique sociale du roman est exprimée à l’aide du choix de musique et reflète dans une certaine mesure les réalités quotidiennes des années 90 dans les régions défavorisées de France. Bien que la musique puisse attirer l’attention sur les dysfonctionnements sociaux, elle ne semble pas vraiment offrir une solution à la situation des adolescent·e·s. L’utilité pour eux et elles est surtout l’assimilation de leurs émotions. Pour changer le système, il faudrait le soutien des personnes influenceuses avec plus de pouvoir et d’opportunités, il s’agit donc d’un cercle vicieux pour les personnes les plus touchées des dysfonctionnements. Considérant le pouvoir que la situation économique et sociale a sur les destins des jeunes, il est d’autant plus important d’assumer les inégalités entre les couches sociales et de travailler contre l’exclusion des groupes défavorisés et l’aggravation du fossé entre les riches et les pauvres, au lieu de soutenir ceux et celles qui ont déjà beaucoup plus qu’il leur faudrait.
Bibliographie
[1] Chauvel, L. (2010). The long-term destabilization of youth, scarring effects, and the future of the welfare regime in post-Trente Glorieuses France. French Politics, Culture & Society, 28(3), 74–96. https://doi.org/10.3167/fpcs.2010.280305
[2] Cobain, K., Grohl, D., & Novoselic, K. (1991). Smells Like Teen Spirit [Lyrics]. Publié par EMI Virgin Songs Inc. / The End of Music. Sur Nevermind. DGC Records.
[3] Gomes, B. (2020). 1990s Grunge and its Effect on Adolescents. Conspectus Borealis, 6(1), Article 19.
[4] Korać, Z. (2014). The contribution of grunge to social change (Undergraduate thesis). University of Zadar. https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:886/datastream/PDF/view
[5] Mathieu, N. (2018). Leurs enfants après eux. Actes Sud.
[6] Shevory, T. C. (1995). Bleached resistance: The politics of grunge. Popular Music and Society, 19(2), 23–48. https://doi.org/10.1080/03007769508591590
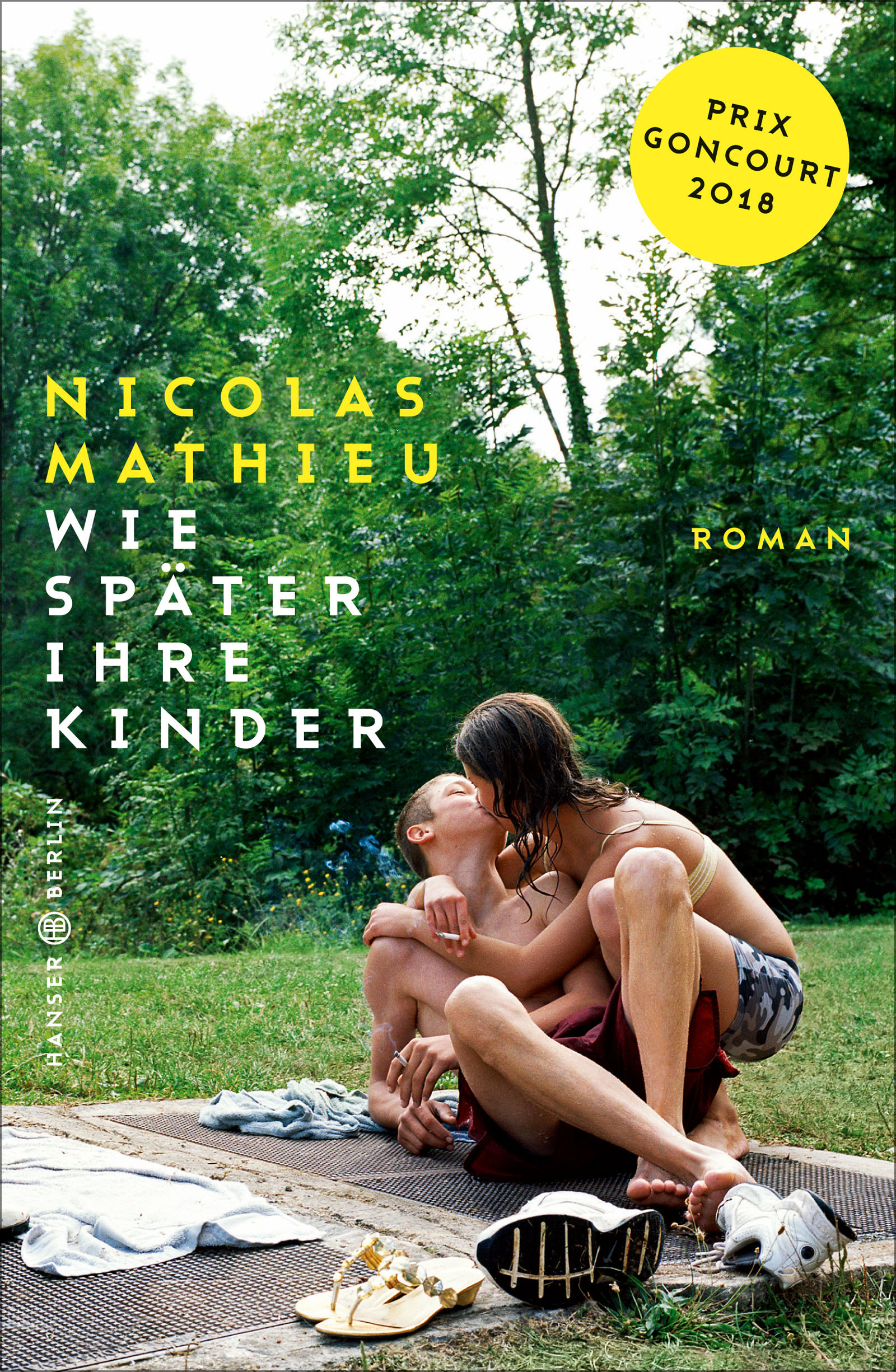
Nicolas Mathieu : Leurs enfants après eux. Réflexion personelle
Nils Altmann
Le roman de Nicolas Mathieu Leurs enfants après eux a obtenu le Prix Goncourt 2018, le prix littéraire le plus important en France. Lorsque j’ai appris cela au cours de mes recherches avant de commencer la lecture du livre, mes attentes ont bien sûr augmentées et j’espérai que cela pourrait me convenir. Maintenant que j’ai terminé les 425 pages, je vous raconterai mes impressions. Le roman a-t-il, à juste titre, une réputation internationale aussi élevée ?
L’intrigue du roman se déroule pendant les années 1990 dans une ancienne région industrielle dans l’est de la France. Au cours de quatre étés, l’histoire suit plusieurs jeunes, surtout Anthony, Hacine et Stéphanie (Steph), dans leur adolescence dans un environnement marqué par le déclin économique, le manque de perspectives et des conflits familiaux. Les jeunes passent leur temps à faire de la moto, à consommer des drogues, à découvrir leur sexualité et à rêver d'une vie meilleure en dehors de leur village. Leurs désirs d'évasion, la recherche de leur identité et la question de savoir s’ils pourront échapper au cercle vicieux de la stagnation sociale et des attentes déçues sont leurs préoccupations principales.
J’ai été particulièrement impressionné par la précision et la richesse des détails avec lesquels Nicolas Mathieu décrit ce monde des ouvriers français et de leurs familles. Les nombreuses références aux noms de marques, aux objets du quotidien, aux conditions de travail et aux habitudes sociales donnent une image convaincante du milieu populaire. Mathieu montre bien comment les gens vivent, travaillent, passent leur temps libre, quelle musique ils écoutent et comment ils parlent de la politique. Toutefois, ce ne sont pas des personnages extraordinaires qui sont mis en avant, mais plutôt l’ensemble de la structure sociale de la région.
Un exemple est la vie en été au bord du lac : L'auteur décrit précisément l'atmosphère, la chaleur, les bruits, le sentiment de liberté et l'ennui que les jeunes y ressentent et comment cette ambiance provoque les vols de canoës au début du roman. Les conversations authentiques des jeunes, dans lesquelles ils parlent de musique, de voitures, de leurs rêves et de leurs soucis, sont également impressionnantes. Ces scènes m’ont donné un accès à leur vie quotidienne et à leur état émotionnel, ce qui m'a permis de mieux comprendre leurs actions.
J’ai aussi beaucoup aimé la façon de raconter l'histoire de plusieurs points de vue. Mathieu donne la parole à de différents personnages de manière détaillée. Cela me confirme qu'une image réaliste de la région est au centre et pas forcément le destin tragique d'un seul personnage, parce qu'on obtient un point de vue sur des vies très différentes. Par exemple, avec Anthony, on découvre à quoi peut ressembler le fait de grandir dans une famille ouvrière, avec Hacine, on a la perspective d'un jeune immigré, et avec Steph, on a un aperçu exemplaire de la vie dans une famille un peu plus fortunée. Mathieu raconte leurs pensées, leurs problèmes et leurs rêves avec respect et sans jugements. Cela permet au lecteur, de mieux comprendre pourquoi les jeunes se comportent comme ils le font et combien leurs chances et leurs difficultés sont différentes.
Bien qu’on puisse apprécier sa finesse pour les détails, elle m’a parfois gênée dans le flux de lecture. Raconter les marques que portent les jeunes, les émissions de télévision qu’ils regardent ou les chansons qui passaient à la radio à l’époque rend le livre très authentique, mais j’ai parfois eu l'impression que ça faisait trop et que l’histoire s’enlisait.
Petit à petit, j’ai constaté que les personnages du roman n’avaient pratiquement aucune chance de changer de vie. Ils grandissent dans une région où il y a peu de travail et peu de possibilités de faire quelque chose par eux-mêmes et rêvent d'échapper de milieu étouffant, mais finissent toujours par y revenir. Je ne me suis plus attendu à un tournant dans l’histoire, puisque la vie des personnages semblait prédéterminée et prévue.
La division de l’histoire en quatre parties me laisse un peu confus. Les moments choisis semblaient un peu irréfléchis, uniquement schématiques tous les deux ans et laissaient souvent en suspens sur ce qui s’était passé entre-temps, surtout au niveau du développement de la personnalité des personnages. En particulier, c’est le changement entre l’été 1994 et l’été 1996 qui m’a laissé avec de nombreuses questions. La relation entre Anthony et Steph est un bon exemple. Au début, il paraît très intéressé à elle, mais elle ne l’est pas à lui. Plus tard, il se comporte renfermée envers elle, sans qu'on sache exactement pourquoi. Steph prend progressivement le rôle plus actif et plus ouvert qu'Anthony avait au début du roman. Malgré que leur relation se brise complètement, au plus tard dans les dernières pages du livre, on ne sait pas si c’est à cause de ses insécurités, de raisons extérieures ou de Steph elle-même. Bref, j’aurais souhaité avoir plus de détails sur les pensées des personnages.
Le langage du roman m’a laissé un peu perplexe. Comme lecteur de langue étrangère dans la version originale française, j’ai eu du mal à comprendre les nombreux mots d'argot et de jeunesse. L’auteur utilise un vocabulaire difficile, qui a beaucoup influencé ma facilité de lecture. Mais j’imagine que pour les francophones, les expressions sont présentes et courantes et qu’il s'agit donc plutôt d’un problème individuel.
En résumé, je pense que le roman Leurs enfants après eux m’a marqué, même si je n’ai pas trouvé tout parfait. Ce qui m'a particulièrement impressionné, c’est que Nicolas Mathieu arrive à donner une place à des personnages qui jouent plutôt rarement un rôle dans la littérature, des jeunes et des familles de la province française qui doivent se battre contre le chômage, le manque de perspectives et les changements de la société. Il donne une voix à ces personnes, sans les idéaliser ou les plaindre.
Même si je ne trouve pas tous les choix stylistiques convaincants, je reconnais la grande importance littéraire et sociale du roman. Leurs enfants après eux est un livre primé pour de bonnes raisons par des prix littéraires internationaux, parce qu’il montre combien la littérature peut aider à rendre visible des réalités sociales et à déclencher de l’empathie pour des personnes qui sont souvent ignorées. Je retiens de ce livre que la littérature peut être bien plus qu’un simple divertissement : elle peut montrer des anomalies sociales, donner des idées de réflexion et élargir son propre regard sur le monde.
Hier Bilder zum Beitrag
Weitere interessante Beiträge
Die beiden Studierenden Anna Seibert und Nils Altmann haben den Roman 'Leurs enfants après eux' von Nicolas Mathieu jeweils ausgehend von ihren Leseerfahrungen kommentiert. Wir freuen uns, dass wir ihre Texte hier mit Ihnen teilen dürfen!

Moritz Heß
Zum ersten Mal waren Universitäten in Deutschland an den Choix Goncourt Internationaux beteiligt – so auch Studierende der Landauer Romanistik


